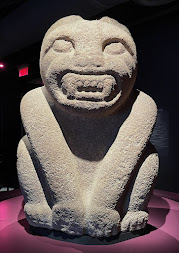La source du rêve
Visites au Québec
lundi 16 juin 2025
Croisière à Tétreaultville, le 16 juin 2025
mercredi 14 août 2024
Montréal, le 14 août 2024
C’est en
5138, selon leur calendrier que nous partons à la découverte du monde des
Olmèques dans le musée de Pointe à
Callière qui, nous le verront, sont les grands responsables de la déchéance de
Montréal comme capitale du Canada.
Ils n’ont
pas laissé de traces écrites, sauf un système numérique qui mesurait le
temps Comme on sait que la terre a 6000 ans, soyons indulgent pour une
petite erreur de moins d’un millénaire. Ils maîtrisaient la connaissance du
zéro (représenté par un coquillage) et estimaient la longueur d’une année à 365
jours, pas si mal.
Les Olmèques
sont, une civilisation de la Mésoamérique qui vécue dans le golfe du Mexique
bien avant les Aztèques et les Mayas, mais ils en sont les précurseurs. D’immenses statues de pierre, 17 au total,
furent retrouvées ainsi que de nombreux autres objets donnant une idée de leur
mode de vie. Les têtes colossales en
pierre exposées sont à couper le
souffle, imaginons leur découverte accidentelle.
Ils avaient maîtrisé
la culture du maïs et de l’hévéa, leur nom vient d’ailleurs de cette
connaissance du caoutchouc. Ils faisaient avec celui-ci des balles pour jouer
au tlacho et des équipements de protection pour les joueurs. À la fin de la
partie, qui consistait à faire passer un lourd ballon dans un anneau sans
l’usage des mains ou des pieds une des équipes était sacrifiée au dieu Jaguar.
L’histoire ne précise pas si c’était l’équipe gagnante ou perdante, de là
l’origine de compter dans son but ?
Il semble
qu’Ils vénéraient le dieu Jaguar et que les sacrifices humains faisaient partie
de leur coutume. Le sang jaillissant d’une tête coupée serait un bon
fertilisant pour la culture du maïs! Autre particularité de ce peuple était la
déformation crânienne pour les jeunes bébés de l’élite. Retenons la culture du
maïs, qui finit par se répandre dans tout le Nouveau-monde.


Tout près du
musée on retrouve l’ancienne caserne de pompier n-1 et la place d’Youville qui de 1844 au 25 avril 1849 était le siège
du parlement du Canada. C’est toute une leçon d’histoire, trop souvent oubliée,
que l’on revit en foulant les ruines de l’ancien marché Sainte-Anne.
Avec l’Union
du HAUT et du BAS Canada, Montréal devient, en remplacement de Kingston la
capitale de cette colonie Britannique. Trois groupes politiques importants
forment le parlement ayant obtenu le statut de gouvernement responsable. Parmi
eux les Tories qui représentent l’élite marchande anglophone de Montréal qui
fait fortune entre autres avec le commerce des céréales (dont le maïs).




lundi 28 septembre 2020
vendredi 25 septembre 2020
Sutton, le 25 septembre
 |
| Il faut suivre la bonne direction sur les trottoirs |
Sutton c’est une vielle anglaise qui a appris le français.
Quand on parcourt ses rues, son histoire, celle de ses notables est
exclusivement anglophone.
Prenons le bon docteur Robert Tyre Macdonald, avec un nom
pareil il aurait pu vendre des hamburgers, mais non il étudie la médecine à
McGill. En 1882 il s’installe ici, et se fait bâtir tout près des églises en
1890. Il exercera 35 ans. En 1898 sa maison comme une grande partie de la vile
brûle.
La femme d’un marchand qui échappe de justesse au brasier
chasse les pilleurs au fouet de cheval.
En 1918 1919, un faxe news de l’époque emporte beaucoup des patients du bon docteur vers l’autre monde.
En après -midi ces dames escaladent le mont Sutton. Est ce qu’on reviendra un jour, la couleur des zones (pandémie) ne cesse de changer, des gardes armées nous barreront-ils l’accès de Longueuil?